|
La malédiction des "Boréades" à Garnier à l'entracte, qui dure et indispose une partie du public, Hugues Gall, le directeur de l'Opéra de Paris, prend la parole. "Pour une fois ce n'est pas de notre faute... Une grave panne d'électricité, rue Tronchet, nous oblige à réenclencher le système électrique de l'Opéra. Nous espérons que Les Boréades pourront enfin être créées dans cette maison..." Interrompues en pleines répétitions de la création, notamment parce que la partition de Jean-Philippe Rameau était d'une redoutable difficulté, ces Boréades n'avaient jamais été données sur la scène de l'Opéra de Paris. Voici qu'elles menacent d'être une fois encore ajournées : William Christie attaque l'acte III ; quelques minutes plus tard, la tension électrique décroît, suivie par un total black out. Le spectacle reprend, sans encombre. Etant donné les circonstances, on émettra avec prudence les fortes réserves que suscite cette première parisienne. Avant et après la panne, l'orchestre et les chœurs des Arts florissants témoignent d'un inquiétant manque d'ensemble (cors perdus, bois peu justes, cordes acides et parfois à la déroute, comme dans l'air "L'amour embellit la vie", acte V). Les départs des chœurs sont flottants et brouillons, les danses sont instables de tempo. Et, dans le seul morceau de l'œuvre où tout doit être vraiment d'une mise en place millimétrée (le génial et préwebernien prélude de l'acte V), Christie n'est pas clair. Le chef franco-américain ne parvient à faire des Boréadesqu'une suite de moments, sans logique entre les tempos (même entre deux pièces aussi organiquement liées que la sublime allemande avec bassons en taille de l'acte IV et le chœur "Parcourez le monde") et ce n'est pas la pâle Barbara Bonney (Alphise), chantant en espéranto baroqueux, ou Paul Agnew, chaleureux et musicien, mais peu à l'aise ce soir dans cette tessiture escarpée, qui rattrapent la faillite musicale de cette première. Excellentes interventions, en revanche, de Stéphane Degout (projection, diction, mise en place) dans le rôle de Borilée. Robert Carsen signe une mise en scène chic et toc de plus. Une idée force, une seule : les forces du plaisir et de la coercition s'opposent (les uns habillés en Men in Black, les autres en sous-vêtements blancs) au cours des quatre saisons. Le tout dans une ambiance glauque, éclairée de biais, avec ce type de décor minimaliste international qui conviendrait parfaitement pour la décoration d'une boutique du styliste Calvin Klein. On a cru régler l'épineux problème des danses (géniale musique) qui parsèment la partition en en confiant la chorégraphie à Edward Lock (compagnie La La La Human Steps). Mouvements épileptiques et amphétaminés, "décalés", "critiques". Osons le dire : à côté de la plaque dans leur modernité désuète. Le public de la première a copieusement hué la chorégraphie et la mise en scène de ce spectacle. Renaud Machart Les Boréades, de Jean-Philippe Rameau, Opéra de Paris, Palais-Garnier, jusqu'au 17 avril (complet). • ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 01.04.03 |
|
Le balai des maudits Par Vincent Agrech La malédiction se poursuit, mais laquelle? Celle frappant les productions baroques de la maison, après le sabotage dont fut victime Jules César (René Jacobs est décidemment le suspect numéro un, puisqu’il jouait avant-hier soir à Paris!)? Ou celle poursuivant l’ultime enfant de Rameau, salué pour sa réception, deux cent trente neuf ans après sa commande, par deux pannes générales d’électricité touchant l’ensemble du quartier, phénomène pour le moins inhabituel? "Ne quittez pas vos places, j’espère que nous parviendrons finalement à créer Les Boréades. En attendant, je vous laisse le loisir d’admirer ce merveilleux plafond pour lequel tout le monde connaît mon affection", est venu dire au public un Hugues Gall en apparence décontracté et pince-sans-rire. L’occasion était d’autant plus forte que ce chef d’œuvre absolu est, chacun le sait, écarté des scènes par le hold-up d’un éditeur se comportant à son égard avec le même amour que le rentier boursicoteur qui trouverait un Watteau dans son grenier – huit pour cent de la recette lui est reversé chaque soir ! Ceux qui n’étaient ni à Aix deux décennies plus tôt, ni à Salzbourg il y a quatre ans entendaient donc pour la première fois à la scène cette féérie fantasque, sensuelle et sauvage, ennoblie du plus éloquent message libertaire des Lumières. Cette définition sommaire laisse bien percevoir que le Rameau cher à notre cœur est plutôt celui de Gardiner, dont on prie tous les soirs pour l’improbable retour (avec si possible un metteur en scène plus concerné que Bob Wilson dans Gluck), moins celui du tandem éprouvé Christie – Carsen. S’il a peu de rivaux sérieux quant à la connaissance du sujet, le premier séduit surtout ce soir par un engagement dont il n’a pas toujours fait preuve ces dernières années (Le Retour d’Ulysse et Les Fêtes d’Hébé mis à part), une structuration ferme et convaincue de l’ouvrage. Les phrasés toujours un peu sautillants, le tempo retenu, la matière souvent clairette d’un orchestre qui n’est pas, lui, dans un soir de gloire (mais le choeur est magnifique), s’apprécieront en fonction de ce que chacun attend de l’ouvrage. Peu d’excuses en revanche pour Robert Carsen, sinon la timidité face à un baroque français qui lui est beaucoup moins familier. Dispositif scénique acoustiquement désastreux et théâtralement sans intérêt, manichéisme primaire qui fusille le sujet, resucée indigeste des spectacles précédents. On n’a certes rien contre les très jolis garçons qui peuplent complaisamment le plateau, mais l’hétérophobie manifeste, le refus de tout érotisme (les femmes sont soit des duègnes espagnoles, soit des nageuses est-allemandes, et les partouzes tristes tournent vite à la sieste des familles) paraît pour le moins décalé. Le bourgeois globalisé occidental semble toujours le seul genre de personnage qui intéresse Carsen, le bon dieu lui offrant à choisir entre le Mal (en noir) et le Bien (en blanc) : avec des idées pareilles, pas étonnant que l’Irak croule sous les bombes américaines. Mais consolez-vous mes frères, tout le monde deviendra gentil à la fin : dans la formidable Flûte d’Aix, les contradictions du livret se voyaient astucieusement résolues. Ici, elles sombrent dans la mièvrerie. Etrangement, c’est à Atys que le metteur en scène avait d’abord rendu hommage, avec une nouvelle variation sur la contrainte des corps écrasés par l’étiquette (le costume), et dont seule la fêlure de la danse exprime l’aspiration à la liberté ; mais la chorégraphie nous entraîne moins vers la névrose que vers le grotesque. Restent évidemment une série d’images merveilleuses, réalisées avec une confondante maîtrise (quoique ces sempiternelles séances de balayage soient bien bruyantes). Mais pour en faire quoi ? Christie défendant l’essentiel, le handicap du spectacle pouvait être surmonté par la distribution. C’est en partie le cas, à une très grave exception près. L’Alphise de Barbara Bonney (qui donc a eu une idée pareille ?), d’un bout à l’autre absurde. Avec son timbre caressant et clair qui scintille dans le haut médium, sa subtile musicalité de récitaliste, elle n’a aucune des qualités du rôle : le tranchant, la tenue de souffle permettant la puissance déclamatoire ou les envolées virtuoses (d’autant qu’elle assume seule l’air du premier acte, et s’y effondre), le médium plein et mordant, les mots ciselés et portés par la ligne musicale – son français demeure à l’état de Chamallow incompréhensible, l’ornementation malaisée. Le metteur en scène a-t-il encore suivi un parti-pris misogyne en la transformant ainsi en nunuche boudinée, ou est-elle seule responsable ? Dès qu’elle quitte la scène, le plateau masculin respire. Et là, que de bonheurs ! Paul Agnew, toujours un peu fragile et mis à mal par la longueur de l’œuvre, toujours avare aussi d’accents héroïques dans un rôle qui demande plus que le moelleux perpétuel, mais phrasant avec un art infini, en un français idéalement sensible et intelligent, dans ce registre mixte d’une rare délicatesse. Frères boréades scéniquement parfaits et transcendant vocalement les ensembles de Spence et Degout, le premier stupéfiant clairon dans l’aigu qui doit simplement veiller aux écarts de justesse, le second d’une densité, d’une probité remarquables, dont l’articulation peut encore gagner un tout petit peu en liberté. Nicolas Rivenq doit comme souvent franchir l’obstacle d’attaques forcées et rigides, mais préserve la dignité de ses caractères dans la pire adversité (pauvre Apollon, transformé en Jésus Christ de show télévangélique dans ce qu’on espère être du second degré, mais qui tombe à plat), Naouri est simplement génial en Borée, rappelant dans la gloire sonore du médium, le délié de chaque mot, la puissance de la caractérisation, quel chemin il a parcouru ces cinq dernières années, et combien sa place est aujourd’hui unique dans le chant français. Inutile de détailler plus avant : gardez les hommes et trouvez une Alphise, conservez le chef ou invitez le à alterner avec le ramélien perdu, brûlez tous les décors et appelez un metteur en scène intéressé par la question. Certes, ça va encore coûter des millions, mais l’une des plus belles musiques de l’histoire vaut bien un petit coup de balai en plus. Paris, Opéra National de Paris - Garnier |
|
ResMusica.com 02/04/2003 Les caprices de Borée Par Bruno Serrou Jamais données du vivant de son auteur, Les Boréades n’ont guère de chance depuis leur conception. Cette œuvre ultime de Jean-Philippe Rameau a non seulement été la première victime du décès du compositeur en septembre 1764 mais a aussi dû subir la vindicte de la censure en raison de son contenu, la partition étant à la fois porteuse d’avenir et l’une des plus subversives du compositeur. Tout d’abord par son livret, qui s’inspire des amours alambiquées de Borée, dieu des vents du nord, et d’Orithie, fille du roi d’Athènes, dont il a eu deux fils qui donnent à Louis de Cohusac l’occasion de dénoncer l’abus de pouvoir aux dépens de la liberté individuelle. Ensuite par la musique, qui, tout en se fondant dans le moule de la tragédie lyrique, amalgame récitatifs secs, accompagnés, airs et ensembles, et intègre le tout au sein du développement de l’action. Rameau ouvre ainsi la voie à la réforme que Gluck mettra en œuvre quelques années plus tard dans son Orphée et Euridice. On y trouve également trace de Mozart, et jusqu’à Berlioz. Il aura donc fallu attendre deux cent trente ans pour que le commanditaire des Boréades, l’Opéra National de Paris pour qui l’ouvrage était originellement destiné alors que l’institution portait le nom d’Académie Royale de Musique, l’accueille enfin cette splendide partition. Il s’agit en fait de la seconde production de l’histoire, vingt et un ans après celle de la création dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence 1982 dans une mise en scène de Jean-Louis Martinoty et sous la direction de John Eliot Gardiner. Aujourd’hui, comme en 1982, c’est dans l’édition d’après le manuscrit découvert à la Bibliothèque Nationale de France par Alain Villain que l’œuvre a été donnée, assimilant ainsi à une page nouvelle une partition conçue voilà plus de deux siècles. Le mauvais sort qui pèse sur Les Boréades à l’Opéra de Paris depuis 1764 se sera finalement maintenu jusqu’au soir de la première, puisqu’une panne de secteur a interrompu le spectacle au tout début du premier entracte, qui s’étira de ce fait sur quelque trois quarts d’heure. Lorsqu’il s’est agi de reprendre, le rideau resta bloqué, et l’on vit Hugues Gall, directeur de l’Opéra de Paris, demander au public de prendre patience, la panne de courant ayant perturbé le bon fonctionnement des ordinateurs de la maison. Mais au beau milieu du troisième acte, une seconde coupure de courant contraignit après quelque hésitation les interprètes à s’interrompre à la fin d’une belle phrase chorale. L’on craignit un moment que le spectacle ne pût reprendre, jusqu’à ce que l’on entendît enfin William Christie demander à ses troupes : " Etes-vous prêts ? " Tant et si bien que, à part les deux premiers actes, il apparaît délicat de juger de la globalité d’une interprétation sur laquelle a pesé tant d’infortune. Néanmoins, dès l’ouverture, l’on a pu percevoir l’excès de nervosité de la direction de William Christie. Le chef poussa tant ses Arts florissants à la vélocité que les approximations se sont avérées par trop nombreuses, à commencer par les cors qui, dans l’ouverture, n’ont pu aligner la moindre note juste, pas plus d’ailleurs que les bois, à l’exception des bassons particulièrement onctueux dans l’acte IV. L’acidité des cordes propre aux ensembles baroques a gommé la dimension prophétique de l’ouvrage. Côté distribution, l’on est en revanche proche de la perfection, si ce n’est Barbara Bonney, qui ne semble pas vraiment à sa place dans le rôle d’Alphise. Paul Agnew est un Abaris solide et chaleureux, Stéphane Degout un impressionnant Borilée. Reste la mise en scène de Robert Carsen, que l’œuvre n’a apparemment pas particulièrement inspiré. Le metteur en scène canadien se sera en effet contenté de dépeindre deux mondes manichéens, celui des méchants dieux aux longs mentaux gris sombres, et celui des amoureux promis vêtus de sous-vêtements blancs. Les décors illustrent les quatre saisons et incitent les scénographes à l’humour bucolique et à jouer de l’assonance ballet/balais utilisée en son double sens, les danseurs jouant souvent du balais, puisque c’est à eux qu’est confié le soin de dégager tour à tour fleurs coupées, feuilles mortes, et neige. La chorégraphie importune et épileptique du Québécois Edouard Lock est par trop envahissante et décalée. Mais comment régler l’épineux problème posé par les longues et belles plages de musique pure qui ponctuent le développement de la narration de cette tragédie lyrique en cinq actes ?... Paris . Opéra de Paris Garnier. 28-III-2003. Rameau, Les Boréades. Barbara Bonney, Anna Maria Panzarella, Jaël Azzaretti, Paul Agnew, Toby Spence, Laurent Naouri, Stéphane Degout, etc. Orchestre et Chœur Les Arts florissants. Direction : William Christie. Mise en scène: Robert Carsen. Décors et costumes : Michael Levine. Lumières : Robert Carsen et Peter van Praet. Chorégraphie : Edouard Lock. |
|
Les Boréades, con un ritardo di 240 anni La nostra recensione. Sulla carta tutto faceva pensare ad un bel colpo dell'Opéra di Parigi. "Les Boréades", l'ultima nata delle opere di Rameau, entrano finalmente nel repertorio dell'Opéra. Ci sono voluti 240 anni: la partitura fu composta nel 1763 e sarebbe dovuta andare in scena l'anno dopo. Se la rappresentazione fu fermata sembra che lo si debba al libretto troppo spinto verso posizioni libertarie. Oggi finalmente il torto è stato riparato. Una scelta che fa onore a Hugues Hall, il direttore in carica della prima scena lirica nazionale. Eppure il miracolo non si è verificato. Qualcosa non fa funzionato. E la macchina si è inceppata. Tanto che in molti, dopo troppi sbadigli, avrebbero concluso che la partitura sonnecchierà ancora qualche anno prima di portarla sul palcoscenico. Certo la colpa non è di Rameau. Anzi. Sono ben altre le partiture di tragédies lyriques francesi, dove un quasi inarrestabile recitativo avvolge lo spettatore per quattro o cinque ore di rappresentazione. Già Goldoni si lamentava. E l'ascoltatore moderno non fa meno fatica di fronte ad uno stile di canto che esteticamente mira ad aderire al dettato della parola. "Les Boréades" però non mancano di invenzione. Uno dei "topos" dell'opera francese, la tempesta, soffia continuamente energia su orchestra, cori e solisti. Basterebbero queste folate di manifestazioni della natura a tenere desta l'attenzione. Purtroppo William Christie tradisce, in modo vistoso, una sua certa tendenza a rallentare, perdendosi in ornamenti e dettagli superflui. È un timoniere che naviga perennemente a vista, non avendo idea della rotta complessiva. E, non a caso, non si va da nessuna parte. Sicuramente mancavano anche alcune decine di ore di lavoro: non pochi sono stati i momenti in cui si aveva l'impressione di assistere ad una prova e non ad esecuzione per un pubblico pagante. L'affondo allo spettacolo lo ha poi dato il regista Robert Carsen, assolutamente in panne. Tanto le sue regie sono solitamente traboccanti di idee, quanto questa sembrava una collezione di "déjà vu", spesso senza legittimità drammaturgica. Ma il vero colpo di grazia è stato inferto dal coreografo e dai ballerini: tutto lo splendore delle danze barocche francesi è stato liquidato in qualche gesto stereotipato (tecnicamente assai incerto). In queste condizioni, chiedere ai cantanti di salvare la produzione è forse un po' troppo. Ma certo hanno fatto del loro meglio. Soprattutto, hanno primeggiato Barbara Bonney, convincente regina in preda a pene d'amore, e il navigato tenore barocco Paul Agnew. Per un'attesa di due secoli e mezzo, si potevano fare qualche sforzo in più. Alessandro Di Profio Les Boreéades (Abaris ou les Boréades) di Jean-Philippe Rameau libretto di attribuito a Cahusac prima rappresentazione: Parigi, Radio 16 settembre 1964 |
|
OPERA Avec deux siècles et demi de retard, «Les Boréades», ultime opéra de Rameau, fait son entrée à l'Opéra de Paris. Christie, Carsen et Lock maîtres d'oeuvre. Par NICOLAS BLANMONT (ENVOYÉ SPÉCIAL À PARIS) Après «Guillaume Tell» (La Libre du 17 mars) et avant «Les Vêpres siciliennes» en juin, l'Opéra de Paris affiche une autre de ses commandes historiques : «Les Boréades», dernier opéra de Jean-Philippe Rameau, achevé peu avant son décès en 1764 par un compositeur octogénaire mais toujours habile. Mais à la différence des ouvrages précités de Rossini et de Verdi, la production des «Boréades» qu'abrite le Palais Garnier est une création : l'Académie Nationale de Musique interrompit en effet les répétitions en 1763, et il fallut attendre 1964 pour voir l'oeuvre créée en concert (à Paris) et 1982 pour la première production scénique (au festival d'Aix). Sensibilité et modernité Comme pour «Les Indes Galantes» en 1999, c'est à William Christie que Hughes Gall a confié la direction musicale de ce Rameau. Les affinités du chef américano-français avec ce répertoire ne sont plus à démontrer, et son sens de la déclamation fait à nouveau merveille, avec des Arts Florissants aguerris qui affichent toutefois quelques faiblesses côté vents. Mais, nonobstant sa structure en cinq actes et ses traditionnels ballets, «Les Boréades» n'est pas seulement affaire de déclamation, mais aussi de sensibilité, avec une série d'airs poignants (notamment le premier air d'Abaris) et d'audacieuse modernité (le début du cinquième acte) : ici aussi, Christie s'avère excellent. Mais si la production des «Indes Galantes» était un florilège de couleurs et d'invention, le spectacle proposé cette fois est marqué du sceau de la noirceur, voire parfois de l'austérité. Pas de décors - tout se joue sur un plateau entièrement noir -, quelques accessoires à peine (une table, des chaises, des balais et des parapluies) et une atmosphère oppressante qui restitue idéalement le manque de liberté de la reine Alphise et de ceux qui l'entourent. Toute la cour de Bactriane, mais aussi Borée et ses fils, sont d'ailleurs vêtus de costumes noirs et corsetés, alors qu'Abaris et les siens évoluent en vêtements blancs et légers : on ne peut plus clairement faire comprendre le contraste entre les deux mondes. N'est-ce pas d'ailleurs l'audace du livret (une reine préfère abdiquer pour suivre celui qu'elle aime plutôt que de se plier aux règles qui veulent qu'elle épouse un des fils de Borée, dieu des vents), bien plus que la mort du compositeur, comme on a longtemps voulu le croire, qui justifia la non-représentation de l'oeuvre à une époque où Louis XV commençait à être qualifié de «mal-aimé» ? Loin d'être gratuite, l'option scénique permet d'aller à l'essentiel - un dépouillement qui évoque plus d'une fois la tragédie grecque - en occultant ce que le style musical de l'époque peut avoir d'un peu décoratif. Fleurs et parapluies Comme souvent, Robert Carsen réussit toutefois à créer nombre d'images fortes qui font sens, et notamment à semer quelques taches de couleurs dans la noirceur ambiante : ainsi, ce tapis de fleurs multicolores qui inonde la scène au lever de rideau mais que les hommes de Calisis et Borilée viendront impitoyablement couper puis balayer (elles seront replantées au final), ces feuilles d'automne aux couleurs rouge et or qui font la transition entre le premier et le deuxième acte, ou cette neige (une constante chez Carsen) qui tombe pour marquer la tempête de l'acte III. Mais à côté du chef et du metteur en scène, il est un troisième homme qui porte cette production : le chorégraphe canadien Edouard Lock, dont la compagnie La La La Human Steps assure les très nombreux ballets qu'appelle l'oeuvre (plus même quelques éléments dansés à d'autres moments) : non point une danse baroque de reconstitution, mais un langage chorégraphique tout à fait contemporain (et même deux, car ici aussi on joue le contraste entre les deux mondes) qui s'intègre remarquablement dans l'opéra. Dominée par un Paul Agnew prodigieux de suavité et bouleversant, la distribution est bonne sans être exceptionnelle : Barbara Bonney campe Alphise comme dans la production de Rattle à Salzbourg, entourée notamment de Laurent Naouri (Borée), Stéphane Degout (Borilée), Toby Spence (Calisis) et Anna Maria Panzarella (Semire). Paris, Palais Garnier, les 13, 15 et 17 avril ; diffusion sur France Musique le 7 juin. © La Libre Belgique 2003 |
|
April 15, 2003 Neglected Baroque Opera Languishes No Longer By ALAN RIDING
PARIS, April 14 — Over the last 20 years the Paris-based American conductor William Christie has played a central role in resuscitating French Baroque music. But this does not mean that Rameau, Lully and Charpentier are exactly household names, even in France. Rameau's last opera, "Les Boréades," has only now entered the repertory of the Paris National Opera, 240 years after it was written. Like its composer, the work was long forgotten. Still, thanks to Mr. Christie and the French-Baroque conductor Marc Minkowski, things have been going better for Jean-Philippe Rameau of late. Four opera-ballets popular in his lifetime — "Platée," "Hippolyte et Aricie," "Castor et Pollux" and "Les Indes Galantes" — are now presented with some regularity in France. In contrast "Les Boréades," completed shortly before his death in 1764, had not been staged for more than two centuries. Its world premiere was at the Aix-en-Provence festival in 1982, in a version conducted by John Eliot Gardiner, another major player in the Baroque music renaissance. Simon Rattle also brought it to the Salzburg Festival in 1999. The production at the Palais Garnier here, with 10 performances running through Thursday, is therefore only the third. "Les Boréades" travels to the Brooklyn Academy of Music for four performances starting June 9, its first full staging in the United States. The new production reunites Mr. Christie, who conducts the orchestra and chorus of his Baroque ensemble, Les Arts Florissants, with Robert Carsen, a Canadian director who works mainly in Europe. The two have frequently collaborated, perhaps most successfully in the Paris Opera's celebrated 1999 production of Handel's "Alcina," later performed in concert version at the Brooklyn Academy. "Les Boréades" is nonetheless Mr. Carsen's first encounter with French Baroque opera. So it seems reasonable to ask, Was the work rightly neglected? Various explanations are offered as to why it was not staged in Rameau's lifetime. The cruelest is that the composer, an octogenarian when he wrote the opera, had gone out of fashion, that Paris Opera lovers had switched their allegiance to the younger Gluck. But the most intriguing is that the opera was censored because, with its occasional cries of "liberté!," Louis de Cahusac's libretto was considered subversive. "Les Boréades," however, also lacks the humor and mischief of "Platée" and "Les Indes Galantes." Alphise, queen of ancient Bactria, must choose a husband between Calisis and Borilée, sons of Borée, the god of the north wind. Alphise prefers Abaris, a ward of Apollo, but Eros rules that she can marry only a descendant of Borée. Fortunately, after much angst all round, Apollo admits that Abaris is his son, mothered by a nymph who was descended from Borée.
Rameau's music is appealingly varied, both in its accompaniment of the singers and in the long musical interludes for ballet typical of many 18th-century operas. The love story assigns the leading roles to Alphise and Abaris, sung with elegance and conviction by the American soprano Barbara Bonney and the British tenor Paul Agnew, while Calisis (Toby Spence) and Borilée (Stéphane Degout) are fully engaged trying to woo Alphise. As with most Baroque operas, in this one the chorus also plays a central role. Working with the contemporary notion of a woman's freedom, Mr. Carsen has placed the story in a stylized modern setting, with Calisis, Borilée and their followers dressed in gray and black suits, and Abaris and his supporters — the good guys — decked out in white (many lying about in pajamas and underwear to suggest the glories of free love). The décor depicts the seasons, starting with a summery stage covered in flowers, followed by falling leaves, snow and rain. This minimalism will certainly facilitate transporting the production to New York. From a director's point of view, though, the opera's main challenge is how to fill the long musical interludes in the narrative. Here Mr. Carsen has opted for two approaches, one more successful than the other. The ballet provided by La La La Human Steps in Montreal is of a style that the company's founder and choreographer Edouard Lock has called "hyperactive." But what resembles a mixture of high-speed semaphore and sign language, albeit often danced en pointe, jars with the music's more bucolic mood. Jacques Doucelin, the music critic of Le Figaro, wrote that the dance added little to "an evening that above all lacked a unified concept." More effective, though, is Mr. Carsen's own crowd choreography as the chorus and extras move around the stage to orchestral music, slowly picking flowers, or parading to a large dinner table, holding knives and forks, or almost dancing as they sweep up the fallen leaves. Mr. Carsen adds other clever visual touches, like extras crossing the stage with upturned umbrellas, spinning out leaves and snow as they walk. He also has Apollo (Nicolas Rivenq) descending somewhat perilously from on high to assure the happy ending. What drives the production, though, is Rameau's energetic music, which includes lengthy recitatives as well as solos and duets of almost-Italian lyricism sung by Alphise and Abaris. Le Monde's music critic, Renaud Machart, complained that Mr. Christie and his orchestra were not in their best form, but evidently no love is lost between the Paris Opera and the newspaper. On Friday Hugues Gall, director of the Paris Opera, announced that since Le Monde was consistently rude about its productions, he was withdrawing advertising from the paper. Still, with 2 hours 40 minutes of music, "Les Boréades" can seem long to those not fully devoted to Baroque music. On the opening night here, March 28, two electricity cuts prolonged the evening by more than an hour. But with only a handful of defections, the public gave a warm curtain call to the singers, conductor, orchestra and director. Some heckles seemed directed at the choreography, but they were drowned out by equally loud cheering. Clearly, for all its formal elegance and unlikely plots, Baroque opera can still stir audiences to a surprising degree of passion. |
|
1.4.2003 Schirme im Sturm Von Joachim Lange In Paris kann schnell mal eine Opernpremiere platzen. Da war es für Hugues Gall diesmal eher eine leichte Übung, nach der Pause zu verkünden, dass "nur" die Technik hinter der Prunkfassade des Palais Garnier streikte. Und das auch nur ein wenig. Die Notbeleuchtung im Foyer lieferte während der Pause historisches Dämmerlicht. Und der folgende Bühnen-Blackout konnte schnell behoben werden. Mag sein, dass es ähnliche technische Schwierigkeiten waren, oder auch Rameaus Tod 1764, die die geplante Uraufführung seiner Boreaden gleich für die folgenden zwei Jahrhunderte kippten. Den königlichen Zensoren dürfte es zumindest erwünscht gewesen sein, denn diese Tragédie Lyrique und das Libretto von Louis de Cahusac sind politisch ein ziemlich starkes Stück. Das Licht der Aufklärung irritierte zwar längst das Ancien régime, doch der revolutionäre Enthauptungsschlag gegen die Bourbonen lag noch knapp dreißig knapp entfernt. Und da schreibt der achtzigjährige Rameau für den Hof eine Oper, in der es um eine grundsätzliche Rebellion gegen die göttliche Ordnung geht. In der sich die Königin Alphise der Staatsraison widersetzt und eben nicht Calisis oder Borilée, einen der beiden Söhne des Windgottes Borée, sondern ihren Geliebten Abaris erwählt, dessen Abstammung im Dunkeln liegt. Für diese Entscheidung verzichtet sie auf Thron und Herrschaft, nimmt sogar die rächende Zerstörung des Landes und ihre eigene Entführung in Kauf. Und auch wenn sich am Ende durch einen deus ex machina-Auftritt von Apoll herausstellt, dass Abaris einem Seitensprung des Lichtgottes mit einer Nymphe der Boreaden entstammt (und damit zur Verwandtschaft gehört), so hätte dieses Aufbegehren eines Individuums gegen die Ordnung und das von einer Nymphe im zweiten Akt herausgeträllerte "C'est la liberté" trotz Rameaus Musik ziemlich schrill in den allerhöchsten absolutistischen Ohren geklungen. Was den Weg des Werkes ins Repertoire trotz John Eliot Gardeniers szenischer Uraufführung 1982 in Aix-en-Provence oder Simon Rattles artifizielle Salzburger Annäherung 1999 auch bei anhaltendem Barockboom erschwert, ist wohl der enorme Anteil von Ballettmusiken. Wenn zwei Drittel Tanznummern sind, lauern bei Kürzungen Substanzgefährdungen und ohne sie tödliche Aufführungsfallen. Gerade hier aber wird das Zusammenwirken des Barockspezialisten William Christie und seiner Arts Florisants mit dem kanadischen Regiekönner Robert Carsen und dessen Choreographen Edouard Lock, der mit der Compagnie La La La Human Steps eine wie im Zeitraffer beschleunigte Barockassoziation gegeneinander brandender Lebensgefühle hoch virtuos einflicht, zum Glücksfall für das disparate Werk. Carsen erweist sich wieder als der Meister der großen, eindrucksvollen Bilder (Ausstattung: Michael Levine). So steht die bedrängte Königin gleich zu Beginn im stilisiert steifen, schwarzen Reifrock mitten auf einer farbenprächtigen Wiese voller Blumen. Die in düsterem Schwarz anrückenden Bewerber aber lassen alle diese Blumen von ihrem Gefolge pflücken und zu Sträußen raffen, um auf geordnetem Grund ihre zackig tanzenden "Geschenke" zu präsentieren. Dagegen gesetzt ist die im warmen apollinischen Licht aufscheinende Lebensfreude um Abaris. Unbefangen, hell und mehr ent- als bekleidet blitzen sie immer wieder zwischen die Dunkelheit; stürmen die übergroße Hochzeitstafel und verunsichern dabei sogar für einen Moment Calisis, der sich zum Mitmachen anregen lässt. Oder wenn die Götter ihre meteorologischen Drohgebärden einsetzen, marschieren Männer reihenweise mit umgekehrten Schirmen über die Bühne und verteilen durch rhythmisches Drehen den Schnee, der dann massenhaft aus dem Bühnenhimmel hernieder geht. Bis letztendlich das Happy End des hohen Paares auf der wiedererstandenen Blumenwiese im einsetzenden Frühlingsregen sogar vom "versöhnten" Boreé (Laurent Naouri) augenzwinkernd beschirmt wird. William Christie fand schnell in seinen farbigen, hochbeweglichen, doch nicht zu leichten historischen Sound; spitzte die expressiven Tänze ebenso aufregend zu wie er die Lebensfreude mit Esprit entfesselte. Nicht nur die Cembalozurückhaltung für den rezitativischen Sprechgesang, sondern auch das dosierte Auftrumpfen würden freilich noch mehr Stimmglanz Raum bieten, als sie vor allem Barbara Bonney (Alphise), Paul Agnew (Abaris) oder Toby Spence (Calisis) über weite Strecke aufboten. Es hat seine gute Opern-Ordnung, wenn Rameau jetzt mit seinem Alterswerk am Palais Garnier vertreten ist - auch wenn das Pariser Premierenpublikum die Verweigerung eines prunkenden Kostümrausches durch das Inszenierungsteam zurückhaltend aufnahm. Palais Garnier, Paris: 3., 6., 8., 10., 13., 15. und 17. April. [ document info ] Dokument erstellt am 31.03.2003 um 17:16:40 Uhr Erscheinungsdatum 01.04.2003 URL: http://www.fr-aktuell.de/ressorts/kultur_und_medien/feuilleton/?cnt=185076 |
|
Der Sturm vor dem Sturm Über fünfzehn Jahre sind vergangen, seit der zum Franzosen gewordene Amerikaner William Christie mit seiner Art, alter Musik zu neuem Leben zu verhelfen, in Paris einzog. "Atys" hiess das Stück, es stammte von Jean-Baptiste Lully, und mit von der Partie war schon damals die grosse Familie rund um das Ensemble Les Arts Florissants. Für die Aufführung war die Opéra comique gewählt worden, damals noch das kleine Haus der Pariser Nationaloper, doch die Vorsicht war unnötig, die Produktion wurde zu einem durchschlagenden Erfolg. Besonderes Aufsehen erregte die Tatsache, dass bei dieser Produktion die Prinzipien der historischen Aufführungspraxis nicht nur auf das Instrumentale, sondern auch auf die Gesangstechnik, die Inszenierung und sogar auf die Choreographie angewandt wurden. Genau das hat die Tragédie lyrique von Lully, die, wie es der Gattung entspricht, einen hohen Anteil an getanzten Divertissements enthält, zu starker Wirkung gebracht - wobei selbst das Höfisch-Zeremonielle zu jener spezifischen Lebendigkeit fand, die das Musizieren bei den Arts Florissants auszeichnet. Inzwischen sind wir ein gutes Stück weiter. Gehört William Christie zu den ganz Grossen im Geschäft, weshalb seine Produktionen im Palais Garnier stattfinden, dem für das ältere Musiktheater und den Tanz reservierten alten Haus der Pariser Nationaloper, und so oft in den Spielplan gesetzt werden können wie "Zauberflöte" und "Carmen". Und ist der Musiker selbst über die Arbeit an den Quellen hinausgelangt zu ebenso subjektiver wie kreativer Interpretation - was bei "Les Boréades" von Jean-Philippe Rameau zu hinreissenden Ergebnissen geführt hat. Das ist darum so bemerkenswert, weil es sich bei dieser letzten Tragédie lyrique Rameaus um ein Stück handelt, das erst seit kurzem bekannt ist. Nach einer privaten Voraufführung am Hof mussten die Vorbereitungen zur öffentlichen Uraufführung 1764 unterbrochen werden, weil der Komponist verstarb. In der Folge verschwand das Werk in den Archiven und wurde erst 1982 durch John Eliot Gardiner beim Festival von Aix-en-Provence zur szenischen Uraufführung gebracht; seither ist es verschiedentlich auf der Bühne erschienen, zuletzt 1999 bei den Salzburger Pfingstfestspielen. Wenn sie so radikal gelesen wird, wie es der Regisseur Robert Carsen und der Choreograph Edouard Lock in Paris tun, kann man das Schicksal dieser Oper verstehen. Zusammen mit dem Ausstatter Michael Levine legen Carsen und Lock den subversiven Zug, ja den vorrevolutionären Impetus des Louis de Cahusac zugeschriebenen Librettos minuziös frei. So begegnet man in Alphise nicht nur einer Königin, die statt einem der beiden Söhne von Borée, dem mächtigen Windgott, viel lieber den sozialen Aussenseiter Abaris heiraten möchte, sondern auch einer Frau, die Individualität und Freiheit des Gefühls über Staatsraison und hergebrachte Regeln stellt - dass die Propagierung solcher Haltung dem Hof damals nicht eben gefallen hat, ist leicht nachzuvollziehen. Dazu kommt eine Partitur, die zwar in manchem - nicht zuletzt im hohen Anteil des Tanzes - den Gesetzen der Tragédie lyrique gehorcht, die sich zugleich aber aufmacht zu einer Flexibilisierung der Form und einer neuen Art Emotionalität. Jedenfalls greift Rameaus Musik hier an mehr als einer Stelle merklich über den Klang des Barocken hinaus, besonders ausgeprägt in der Verwendung zweier Klarinetten. All das wird im Palais Garnier ebenso liebevoll wie unbarmherzig vorgeführt. William Christie, der Chor und Orchester von Les Arts Florissants voll hinter sich weiss, lotet die furiosen wie die zärtlichen Seiten der Musik voll aus - und geht dabei entschieden weiter, als es Simon Rattle 1999 in Salzburg wagte. Und auf der Bühne herrscht zum einen der scharfe Kontrast zwischen der in ihren Regeln und ihren Ansprüchen gefangenen Gesellschaft, die im schwarzen Einheitskostüm auftritt, und der auf freie Vitalität eingeschworenen neuen Generation, die in weisse Unterwäsche individueller Faktur gekleidet ist. Herrscht vor allem aber der extreme Tanz der kanadischen Gruppe La La La Human Steps. Hier gibt es nun - abgesehen von einer einzigen, zitathaften Stelle - nicht mehr das gezügelte Schreiten des höfischen Tanzes, hier dominiert entfesseltes Zucken. Vieles aus dem Bewegungsrepertoire dieser auffallend durchtrainierten Tänzerinnen und Tänzer ist aus dem klassischen Ballett und dem Tanz auf der Spitze bekannt, aber Tempo und Dichte dieser Bewegungen schnüren einem förmlich den Hals zu - kein Wunder, dass das Publikum schon vor der ersten Pause gegen diese existenzielle Art Körpersprache aufbegehrte. Gewiss ist hier manches einseitig und anderes störend; die Anregung wirkt aber nachhaltig. Wird die Strenge der etablierten - wenn auch massiv gefährdeten - Ordnung vorab durch das Tänzerische dargestellt, so kommt der Aufbruch im Zeichen der Liebe (im weiteren Sinn: der gesellschaftliche Aufbruch) im hellen Licht und in Requisiten zum Ausdruck: in den zahllosen, über den ganzen Bühnenboden verteilten Blumen, die vom unerbittlichen Gärtner ausgerissen werden, oder in den bunten Herbstblättern, die in einer Dichte sondergleichen auf den Bühnenboden herabfallen, von den schwarzen Strassenwischern aber auf der Stelle beiseite geschafft werden. Überhaupt ist Carsens vielschichtige Deutung von manchem zart ironischen Schwenker durchsetzt - etwa dort, wo der rettende Apollo, der sich als Vater des Aussenseiters Abaris zu erkennen gibt, seinen Auftritt als wahrer Deus ex machina inszeniert bekommt. Blendend zudem die vokale Umsetzung. In der Rolle der Königin Alphise hat Barbara Bonney, die diese Partie schon in Salzburg verkörperte, wiederum einen grossen Abend; bravourös meistert Paul Agnew (Abaris) die extremen Anforderungen seiner hoch gelegenen Partie, und in der ganz kleinen Rolle einer Nymphe fällt Jaël Azzaretti mit ihrem hellen Sopran auf. Selten genug kommt es im Opernbetrieb zu derart fruchtbaren Provokationen; und schon steht für William Christie ein nächstes Rameau-Projekt an: "Les Indes galantes" mit Heinz Spoerli am Opernhaus Zürich. Peter Hagmann |
|
Altamusica.com Première des Boréades au Palais Garnier, Paris. Voilà 239 ans que l'ultime tragédie lyrique de Rameau attendait de faire son entrée à l'Opéra de Paris. Œuvre maudite? Peut-être, car cette première ne fut pas de tout repos. Mais au final, une musique sublime, résistant à tous les traitements. Rameau est bien le grand triomphateur de cette production des Boréades. Par Françoise MALETTRA Pour une fois, le fantôme de l’Opéra n’était pour rien dans l’insolente panne d’électricité qui a bien failli compromettre les amours déjà difficiles des héros des Boréades. Contre les caprices d’un transformateur de la voisine rue Tronchet, Borée, le dieu des vents du Nord en personne, risqua de perdre définitivement la partie avant l’heure fixée par Rameau. Noir total au premier entracte, longue errance du public dans l’obscurité des foyers, reprise sur un troisième acte à son tour frappé de plein fouet par un nouveau blackout. EDF, qui s’était montrée trop chiche en puissance, corrige, et le courant est rétabli, sans plus d’incidents, jusqu’à la fin (tardive) du spectacle. Difficile, dans de telles conditions, de juger honnêtement d’une production tant attendue, qui faisait enfin son entrée au répertoire de l’Opéra de Paris, après un long purgatoire de 239 ans, interrompu en 1982 au Festival d’Aix-en-Provence, et en 1999 au Festival de Salzbourg. Car l’Académie Royale de Musique, commanditaire de l’œuvre à Rameau, n’honorera pas ses engagements : la création qui devait avoir lieu en 1763 sera ajournée, pour ne pas dire purement et simplement censurée, en raison des aspects subversifs d’un livret, jugé d’inspiration franc-maçonnique, qui mettait en scène un pouvoir déniant toute liberté à l’individu et le droit d’une reine à l’insoumission au nom de l’amour. Rameau devait mourir un an plus tard, abandonnant au silence un ultime chef d’œuvre, qui à l’image de ceux qui l’avaient précédé, ouvrait une voie royale à Gluck et Mozart. La partition des Boréades regorge d’inventions, d’idées musicales lancées, variées, masquées ou clairement énoncées, qui tissent les liens du tissu dramatique, cernent et enlacent les personnages en leur donnant de la chair et du sens. Elles disent la violence, la cruauté, la terreur, la douceur des amours et la force invincible des sentiments. On est loin, très loin, d’un Rameau au cœur aride et à la raison triomphante, mais si proche du musicien philosophe qui tient à distance Voltaire et Rousseau, et livre l’art des temps à venir dans la vision prophétique d’une société en marche vers son nouveau destin. Faut-il mettre sur le compte d’une soirée passablement perturbée, les imprécisions de l’Orchestre des Arts Florissants et les quelques difficultés à réaliser une véritable fusion entre la fosse et le plateau ? Peu importe. William Christie restitue toute la splendeur et les raffinements de la musique de Rameau, en engageant musiciens et chanteurs dans un même élan de jeunesse, toujours habité par la rigueur d’un style dans lequel ils excellent. La distribution est dominée par Paul Agnew, magnifique Abaris, et les trois barytons français Laurent Naouri, Stéphane Degout et Nicolas Rivenq, indiscutablement parmi les meilleurs de leur génération. Malgré de beaux accents, une réelle présence scénique et une science du chant qui n’est pas en cause, Barbara Bonney, Alphise, se heurte aux lois de la déclamation baroque, ou pire, semble les ignorer. Quant à la chorégraphie d’Edouard Lock, entre gymnastique rythmique (mais sur pointes) et corps déchaînés d’une jeunesse affolée, elle donne le sentiment de raconter une histoire étrangère à celle qui nous est donnée à entendre par Rameau. Pour célébrer cet hymne à la liberté et à la fraternité, Robert Carsen imagine un champ de fleurs au premier acte, et un tapis de feuilles d’automne au second, s’envolant d’immenses parapluies retournés. Atmosphère Peace and Love, prestement réprimée par des hommes en noir, armés de râteaux balayeurs, déterminés à rétablir l’ordre dans le royaume. On était loin du merveilleux baroque et de ses enchantements, mais on savait déjà qu’Alphise, la reine insoumise, refusait de prendre pour époux un des princes boréades désignés par les dieux, et qu’elle aimait Abaris, un jeune homme sans naissance. On se doutait qu’elle ne céderait pas. Les images en noir et blanc, belles mais glacées, allaient alors servir de cadre à la fête tragique : révolte de la reine, colère des dieux, ouragan sur la cité dévastée, enlèvement de la rebelle et descente aux enfers. Représentations les 3,6,8,10,13,15,17 avril 2003 |
|
By Lynne Walker
There's an ill wind blustering around the Opéra de Paris's first-ever
production of Jean-Philippe Rameau's last opera, Les Boréades. Thought to have
been rehearsed in Paris in the 1760s, hampered by the burning down of the opera
house, and changing tastes, and discarded perhaps because of the composer's
death, it has taken nearly 250 years to reach the Paris stage, attracting
endless controversy on the way. Gallic mutterings and copyright disputes still surround Sir John Eliot
Gardiner's performing edition, which finally made it to Paris in a new and
stylised staging by Robert Carsen. But the opera blew a fuse on its opening
night, plunging the audience into darkness twice, delaying the performance by
more than an hour, and provoking a storm of criticism in Le Monde. Freed from the difficulties experienced in Paris, the concert performance
coming to London's Barbican will surely lack little in the way of theatricality,
given William Christie's authoritative and illuminating direction, and the
spirited playing from France's leading period-instrument ensemble, Les Arts
Florissants. Shame, of course, about the absence of the field of flowers, the
upturned umbrellas spilling autumnal leaves or sprinkling snow according to the
season, and the conflict in costumes between the black-clad world of the north
wind's Boreas and the airy lightness of the decidedly hippier realm of
Apollo. But even without Michael Levine's minimal set and props, there will be much
pleasure to be had from Rameau's inventive score, undistracted by the energetic
but peculiarly unidiomatic dance routines of Edouard Lock's guest company, La La
La Human Steps. The tale of the royal Alphise, beautifully sung by Barbara Bonney (revisiting
the role that she sang for Simon Rattle at the Proms in 1999), destined to marry
a descendant of Boreas, god of the harsh north wind, is nothing less than highly
charged. Alphise loves neither Borileas or Calisis, persistent suitors both,
characterfully depicted by Stéphane Degout and Toby Spence, respectively. She
has been swept off her feet by Abaris, sung with eloquence by Paul Agnew. Their
forbidden love seems hopeless until his divine origins are revealed and, with
the help of Cupid's arrow, darkness turns to light, so that Boreas's dingy
domain is suffused in glowing colour, literally and metaphorically. It is Rameau who emerges as the real hero of Les Boréades, in bold rhythms
and daring melodic lines, in the charming evocation of a clock in the "Gavotte
pour les heures", the threatening tempest and torture scenes, and the
uninhibited quality of the choruses. Most of all, however, in the sympathetic
musical portrayal of each character, the elderly composer seems himself to have
been touched by a magic arrow in his imaginative resourcefulness |
|
Jorge Binaghi
Vientos desatados ante el furor paterno por la falta de disciplina de una
reina que no quiere casarse sino con la persona de su elección, y que sólo
se calman justo a tiempo de evitar estropicios mayores gracias al oportuno
"deus ex machina" que revela la nobleza del origen secreto del amante y su
relación con el furioso dios de los vientos ... En la versión de Robert
Carsen, absolutamente clara, el negro y el blanco se oponen en medio del
paso de las estaciones, luchan y por fin, pero con esfuerzo, vence el
blanco. Nunca como hasta ahora Carsen había sido tan esencial, tan poco
tentado por su "inteligencia" (hay algún guiño simpático, como cuando uno de
los pretendientes desairados se da un atracón con la tarta de bodas mientras
su hermano se dedica a cortejar a la dama de honor de la reina) y ha hecho
entender por qué la obra era indigesta y por qué, tal vez, sigue sin ser hoy
demasiado digerible por los poderosos de turno, aunque su relación con la
música (si existe) haya cambiado. La La La Human Steps es una compañía canadiense fabulosa aunque tal vez
no siempre sean sus gestos y movimientos los más adaptados o adaptables a la
música de Rameau, pero contribuye a la agilidad del largo espectáculo (casi
tres horas y media con dos intervalos). La parte musical es prácticamente un sueño. El conjunto y su director
creen en lo que hacen y aman esta música: mirarlos es casi otro espectáculo
y difícil permanecer insensible a una labor que, dentro del nivel
profesional más elevado, guarda la pasión y la frescura de un primer
contacto. Admirable, maestro Christie. Después, claro, están los cantantes-actores: de un conjunto excelente en
ambos aspectos es injusto andar buscando "menos" y "más", pero es claro que
la voz menos agraciada, la de Agnew -de una solvencia estilística e incluso
técnica notables- estaba en desventaja, sobre todo por cierta opacidad
general y alguna tensión en el agudo (aunque el breve último acto
-probablemente el mejor en todos los aspectos- lo encontró por fortuna
superado). Rivenq estuvo bien en su doble rol, pero lo hemos visto mejor y
más interesado. Panzarella tiene una parte ingrata y antipática pero canta
magníficamente. La breve parte de Azzaretti, en dos oportunidades, le da
gran ocasión de lucimiento. Si fuera cuestión de musicalidad, voz y
prestancia escénica, habría que decir que el amor es ciego: con un Borée
como Naouri (que lamentablemente no aparece hasta el último acto, pero su
presencia se hace notar, y cómo) y unos hijos como Spence (de timbre tenoril
brillante aunque con algún extremo agudo incierto) y sobre todo el magnífico
Degout, la reina debía de estar perdidamente enamorada del otro. Se le
perdona porque, además, la interpretaba -muy bien- y la cantaba -de modo
literalmente perfecto por su francés, sus recitativos y sus brillantes
agudos en pianísimo- nada menos que Barbara Bonney, que ya había tenido a su
cargo la parte hace unos años en Salzburgo. Que los vientos sigan siendo
favorables al último aporte de Rameau gracias a artistas como estos. París, 13 de abril de 2003 |
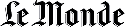










 Una obra que tarda más de doscientos años en estrenarse en absoluto y diez más para que se estrene en la ciudad que la encargó y en la sala que sucede a la de entonces, la Académie Royale de Musique. De un autor famoso que
cumplía su última labor lírica. Es fácil entender que no haya gustado el tema, demasiado individual, demasiado insistente en el libre albedrío y en los caprichos de los poderosos de turno hasta que alguien más poderoso -y racional- los hace entrar en razón.
Una obra que tarda más de doscientos años en estrenarse en absoluto y diez más para que se estrene en la ciudad que la encargó y en la sala que sucede a la de entonces, la Académie Royale de Musique. De un autor famoso que
cumplía su última labor lírica. Es fácil entender que no haya gustado el tema, demasiado individual, demasiado insistente en el libre albedrío y en los caprichos de los poderosos de turno hasta que alguien más poderoso -y racional- los hace entrar en razón.