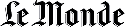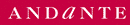|
Musique: "Guillaume Tell" à l'Opéra de Paris, pour la première fois depuis soixante-dix ans Soixante-dix ans que Guillaume Tell – mythe fondateur de la Confédération helvétique se libérant d'un siècle de joug autrichien – n'avait pas été monté dans sa version française originale à l'Opéra de Paris. De là à prendre l'Helvétie pour éclairer nos lanternes, il n'y a qu'un pas, que Francesca Zambello franchit avec l'allégresse d'une Heidi à la montagne. Sombres forêts et verts pâturages, intérieurs chalets et costumes traditionnels à peine revisités, tout y est, dans un total look bois qui a fait les soldes chez Lapeyre. On attend la sympathique vache mauve du chocolat Milka, les jodels bon enfant des rigolards de chez Ricola. Mais ce n'est pas le moment. Les Autrichiens sont partout. Partie de chasse autrichienne, chapeaux à plume et gibier à poil ; partis à la guerre autrichienne, enseignes à tête d'aigle et casques à pointe. On est au plus mal: en témoignent les lambris en débris, lattes des murs explosées à cour et jardin. Bien pratiques pour faire circuler tout ce monde qui va et vient, monte des escaliers en courant pour les descendre aussi vite, et, surtout, passe on ne sait pourquoi le plus clair de son temps à danser. L'inspiration de Blanca Li suit le mouvement, qui reste au niveau du plancher des vaches, en dépit de fréquents portés et autres pseudo-acrobaties éculées. Même les fameuses lumières de Jean Kalman, grand sculpteur des montagnes – rocheux adrets, sylves ubacs – n'y pourront mais. Reste la musique. Peu à dire de l'orchestre, si ce n'est l'excellent état de fonctionnement de ses instrumentistes. Idem pour des chœurs très sollicités. Car la direction honnête et précise de Bruno Campanella manque furieusement de panache, qui se complaît à des tempos de rentiers, affichant les couleurs bienveillantes de la neutralité. Ça ne fait pas le bonheur de tout le monde. A commencer par le Guillaume Tell falot d'un Thomas Hampson à contre-emploi, manquant de projection ou vociférant, sans posséder pour autant les graves du rôle. SPECTACLE FILANDREUX Un rien coincé dans les hauteurs, l'Arnold de Marcello Giordani ira libérant simultanément sa patrie et ses aigus pour nous chanter un "Asile héréditaire" aux vertus méritoires, le médium se voilant quand le sommet se dégage (la météo des voix comme celle des montagnes, etc.). Si la Mathilde de Hasmik Papian chante le français avec des accents inusités, la voix est jolie et sait moduler la séparation d'amour pour raison d'Etat – Sissi peut-elle aimer un Suisse ? Quant au valeureux Jemmy (Gaële Le Roi), à l'instar de son père, Tell fils a de qui tenir et porte la pomme avec élégance, cependant que Hedwige, sa mère (Nora Gubisch), prouve que n'est pas la femme d'un Tell qui veut. Marie-Aude Roux Guillaume Tell, opéra de Gioacchino Rossini, d'après Schiller. Avec Hasmik Papian (Mathilde), Gaële Le Roi (Jemmy), Nora Gubisch (Hedwige), Marcello Giordani (Arnold), Thomas Hampson (Guillaume Tell), Wojtek Smilek, Alain Vernhes, Jeffrey Wells, Gregory Reinhart, Peter Davison (décors), Marie-Jeanne Lecca (costumes), Jean Kalman (lumières), Blanca Li (chorégraphie), Francesca Zambello (mise en scène), Orchestre et Chœurs de l'Opéra national de Paris, Bruno Campanella (direction). Opéra-Bastille, place de la Bastille, Paris-12e. M° Bastille. Le 14 mars. Prochaines représentations les 17, 20, 26, 29 mars, les 3, 8 et 10 avril à 19 heures, le 23 mars à 14 h 30. Tél. : 08-92-89-90-90. De 10 à 109 € . • ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 18.03.03 |
|
Musique -OPERA Apres 71 ans d'absence, l'Opéra de Paris remet à l'affiche "Guillaume Tell". Par NICOLAS BLANMONT (ENVOYÉ SPÉCIAL À PARIS) Page célèbre entre toutes, l'ouverture est à l'image de ce que sera la direction musicale de Bruno Campanella tout au long de cette représentation: stylée et nette, à défaut d'être passionnée ou passionnante comme l'avait été celle d'Alberto Zedda lors des récentes représentations liégeoises. Après 71 ans d'absence, l'Opéra de Paris retrouve enfin "Guillaume Tell" créé en 1829 pour la grande maison parisienne. Jusque 1932, l'ultime opéra de Rossini y avait été représenté 911 fois. Premier volet d'un triptyque de retour aux sources puisque deux autres raretés écrites pour la maison suivront: "Les Boréades" de Rameau fin mars, et "Les Vêpres siciliennes" de Verdi en juin."Guillaume Tell" est donc donné dans sa version originale en français, mais néanmoins surtitré. Paradoxal? Le paradoxe réside surtout dans le fait d'avoir confié cette v.f. à une distribution majoritairement non francophone, avec des chanteurs dont la diction imparfaite rend nécessaire cette lecture d'appoint. Ce n'est sans doute pas le cas de Thomas Hampson, dont on sait l'aisance d'adaptation linguistique. Pour sa prise de rôle, le baryton américain campe un Tell à la présence scénique à la fois tranquille et impressionnante, mais il faut attendre le bouleversant "Sois immobile" du troisième acte pour que la voix atteigne le niveau de rondeur, de puissance et d'aisance auquel elle nous a habitués. La puissance et l'engagement sont les qualités premières de l'Arnold de Marcello Giordani, mais c'est au prix d'une justesse plus d'une fois aléatoire. Hasmik Papian est une Mathilde très professionnelle, mais à qui manque la passion juvénile qu'on peut attendre du rôle. Outre l'excellente Hedwige de Nora Gubisch, c'est le Jemmy de Gaële Le Roi que l'on saluera avant tout: voix sûre et remarquable d'émission, engagement constant, la soprano habituée aux rôles d'enfant réussit ici une incarnation d'anthologie. Au soir de la première, une partie de la salle a sifflé Francesca Zambello et a crié "Patronage". On attendait en effet de la metteur en scène américaine plus que cette illustration en chromos d'Helvétie: morceau de montagne façon tremplin de ski, décors en bois blanc sorti d'un lambris de cuisine de chalet suisse, accumulation de drapeaux, râteaux, faux et fourches. Loin de magnifier le sentiment patriotique qui traverse l'oeuvre (c'est aussi l'époque de "La muette de Portici"!), la mise en scène ne quitte presque jamais le niveau de l'anecdote: les protagonistes, privés de réelle épaisseur psychologique, ont tendance à surjouer et les choeurs sont mus avec une naïveté incroyable à ce niveau. Même si les coupures effectuées ici ramènent la partition à trois heures de musique, il faut attendre le troisième acte et la fameuse scène de la pomme pour ressentir une véritable émotion. Restent, puisque les ballets sont donnés, des chorégraphies qui, au début, frisent elles aussi le folklorique, puis peu à peu se déjantent gentiment en partant vers la comédie musicale américaine: mince souffle d'air frais dans un spectacle si obstinément coincé au premier degré. © La Libre Belgique 2003 |
|
Dans le lac, avec des fers attachés aux pieds Ce n’est point que la vache Milka n’ait bercé notre enfance, ni que les coucous évoquent en nous quelque souvenir désagréable. Gloire à la Suisse, à son hospitalité légendaire dont tant de philosophes et de directeurs de théâtre firent l’heureuse expérience, merci à la Croix Rouge pour tant de sollicitude apportée au monde, et mangez des pommes. Tenez, celle du fiston Tell par exemple, dont un bout nous reste quand même en travers de la gorge en sortant de ce spectacle qui ferait passer la production d’Attila pour un sommet de konzeptheater ou celle d’Idoménée pour un modèle de grâce aérienne. On a connu Francesca Zambello lourdingue, platement littérale, kitsch, indifférente, parfois même chef de troupe inspiré et formidable mécanicienne de grosses cylindrées; mais à ce point grotesque et creuse, jamais. Des décors dont même votre petit garçon de cinq ans ne voudrait pas sur le papier peint de sa chambre et une direction d’acteurs façon langue des sourds laissent un instant espérer un zeste d’autodérision ou de trente-sixième degré, que rien, hélas, ne viendra confirmer. Car même le délicat Jean Kalman se décourage dans ses éclairages à la truelle, tandis que Blanca Li, à part quelques tics géniaux, s’étale de tout son long – l’opéra est fatal à ce grand talent. La direction d’orchestre sera à l’avenant: inconsistante et antidramatique (quelqu’un dans cette maison a de la suite dans les idées), ces violoncelles merveilleux, ces vents extasiés paraissant jouer tout seuls. Alain Vernhes, Nora Gubisch et Gaëlle Le Roi nous sauveraient la soirée. Des mots, du timbre, des personnages. Giordani chante des notes, dont certaines ne manquent pas d’impact. Hasmik Papian, artiste considérable (elle est l’une des rares Norma audibles aujourd’hui, ce qui n’est pas peu dire) s’empêtre dans le français comme dans le phrasé, où son timbre large et composite perd toute unité, mais rappelle dans l’acte final l’ampleur de ses moyens. La présence physique de Hampson s’accompagne comme souvent d’une certaine neutralité psychologique qui sied peut être à la nationalité, mais pas au tempérament du protagoniste. Une diction bien étudiée, le souffle conduit avec fermeté nous valent quelques très beaux moments, mais le chef fait dans l’air son seul geste de la soirée (et ce sera le mauvais) en serrant le tempo, la tessiture un peu grave privant de ses avantages un timbre qui tend de surcroît à se décolorer de plus en plus souvent dans les rares piani. Bref, c’était comment l’Helvétie? Plat! Vincent Agrech Paris, Opéra National de Paris Bastille |
|
ResMusica.com Guillaume Tell victime d’un trait américain Rédacteur: Bruno SerrouVoilà près de trois quarts de siècle que Guillaume Tell de Rossini avait disparu de l’affiche de l’Opéra de Paris pourtant commanditaire de l’ouvrage. Le compositeur italien, qui, avec cette partition, ouvrait la voie au grand opéra à la française, genre dans lequel allaient s’illustrer les Meyerbeer, Halévy, Auber, et jusqu’à Verdi avec Don Carlos, signait avec Guillaume Tell son dernier opéra. Jouée cinquante-six fois dans sa première production créée le 3 août 1829, puis, jugée d’une longueur excessive, l’œuvre ne fut plus donné que dans une version concentrée en trois actes. Ce n’est qu’en 1856 que l’Opéra reprit la version en quatre actes, mais jamais dans la totalité de ses cinq heures. Un soir de 1932, à l’issue de la neuf cent onzième représentation, Guillaume Tell fut biffé de la programmation de l’Opéra de Paris où il réapparaît cette saison, après soixante et onze ans d’absence. Cet avatar d’un genre que l’on essaie vaille que vaille de remettre au goût du jour ne saura malheureusement convaincre le public d’aujourd’hui de sa viabilité dans la production que propose l’Opéra Bastille. Inspiré du Wilhelm Tell de Schiller, le livret français de Victor-Etienne de Jouy, quoique " amélioré " en son temps par Hippolyte Bis, est d’une totale indigence avec ses vers de mirliton, et s’il a prêté à sourire dès la création, cela ne peut aller en s’arrangeant avec le temps. Et ce n’est pas la mise en scène de Francesca Zambello qui fera oublier ce côté désuet! La vision surannée de l’Américaine suscite deux questions tant le jeu des chanteurs est ampoulé et statique. Soit Francesca Zambello a joué à fond la carte du vieillot soit elle n’a su que faire de cet ouvrage qui l’encombre. L’on retrouve ses tics faits de tableaux figés monumentaux, d’absence totale de direction d’acteur, les chanteurs étant laissés à l’errance sur le vaste plateau de Bastille. Seuls les artistes authentiques réussissent à intéresser, particulièrement Thomas Hampson, Nora Gubisch, Alain Vernhes et Gregory Reinhart, qui sauvent à eux seuls le spectacle de la dérive. Le charisme naturel d’Hampson donne au héros suisse une majestueuse stature, et sa voix, moins assurée que de coutume, reste ferme et colorée, et l’on ne peut qu’exprimer son enthousiasme devant la vaillance de sa ligne de chant. Nora Gubisch, après une première partie laborieuse due à un la succession de deux spectacles différents en deux jours sur cette même scène, Perelà et Guillaume Tell, est une touchante Hedwige, son timbre de velours et le charme sculptural de sa personnalité attisant le plateau entier. Gregory Reinhart est victime du même enchaînement en deux jours des deux ouvrages actuellement à l’affiche de Bastille, mais, tout comme Nora Gubisch, prend peu à peu la mesure de son emploi. La noblesse de la prestation d’Alain Vernhes donne à regretter de la brièveté du rôle de Metcthal. Gaël Le Roi est excellente en fils de Tell, ainsi que Marcello Giordani à la voix sûre et pleine sur la totalité du registre de sa voix. En revanche, Hasmik Papian déçoit en Mathilde. Réalisée par Blanca Li, la chorégraphie, qui frise le ridicule, ne fait qu’amplifier la déception que suscite cette production. Reste l’orchestre qui, malgré la beauté de ses sonorités, ne parvient pas à sortir le spectacle de la torpeur. Il souffre en effet de décalages dès l’ouverture, pourtant l’un des sommets de la création rossinienne, avec notamment sa somptueuse introduction au violoncelle solo. En fait, les musiciens semblent se désintéresser de la partition qui compte pourtant quelques-unes des plus belles pages de Rossini, comme l’air d’Arnold au premier acte, le trio Arnold, Tell et Walter au deuxième, le monologue d’Arnold au troisième, ou le chœur final chantant la liberté conquise. Il faut avouer que Bruno Campanella, à force de chercher à éviter les lourdeurs rythmiques, a fini par négliger les contrastes et les nuances propres à l’ultime opéra, le Cygne de Pesaro, qui, après l’incompréhension qu’il aura suscitée, se retira définitivement de la scène lyrique à l’âge de trente-sept ans, pour couler une paisible retraite pendant les trente-neuf dernières années de sa vie… Paris. Opéra de Paris Bastille. 14-III-2003. Rossini, Guillaume Tell. Thomas Hampson, Nora Gubisch, Gaële Le Roi, Marcello Giordani, Alain Vernhes, Wojtek Smilek, Jeffrey Wells, Hasmik Kapian, Gregory Reinhart, etc. Orchestre et Chœur de l’Opéra National de Paris. Direction : Bruno Campanella. Mise en scène : Francesca Zambello. Décors : Peter Davison. Costumes : Marie-Jeanne Lecca. Lumières : Jean Kalman. Chorégraphie : Blanca Li. |
|
Le retour de l'archer triomphant A sa création en 1829, l'ultime opéra de Rossini ne manqua pas de dérouter une partie du public et de la critique, tant par son ampleur - plus de quatre heures de musique - que par la nouveauté de son écriture. Le succès fut néanmoins au rendez-vous et alla grandissant au fil des représentations, tandis que des coupures de plus en plus importantes étaient opérées, jusqu'à réduire l'oeuvre à trois actes. Adolphe Nourrit lui-même, créateur du rôle d'Arnold, renonça assez rapidement à chanter le fameux "Asile héréditaire", suppression impensable de nos jours. Il faudra attendre la reprise de 1837 pour que cet air retrouve sa place, grâce à Gilbert Duprez, qui le couronna de son fameux contre-ut de poitrine dont on sait la postérité (au grand dam du compositeur, rappelons-le), signant ainsi l'acte de naissance du ténor di forza de l'opéra romantique. Entré au Palais Garnier dès 1875, l'ouvrage atteignit les 886 représentations à l'occasion de son centenaire. Affiché une dernière fois en 1932, il ne devait plus être rejoué à l'Opéra de Paris avant la reprise actuelle. À l'étranger, il fut donné sporadiquement, notamment en Italie, dans une version traduite et considérablement amputée. En 1988, Riccardo Muti le dirige à la Scala dans une édition quasi intégrale, mais toujours en italien, qui fera l'objet d'un enregistrement remarqué chez Philips. L'année suivante, une partie de la distribution scaligère se retrouve sur la scène du Théâtre des Champs-Elysées autour du Guillaume Tell de José Van Dam, pour une série de représentations mémorables, en français cette fois, que la nouvelle production de l'Opéra Bastille ne saurait faire oublier tout à fait. On pourrait gloser indéfiniment sur la nécessité des coupures dans un opéra extrêmement long que Rossini lui-même a dû élaguer pour le rendre viable sur scène : fallait-il pour autant le réduire à trois heures de musique quand on n'hésite pas à donner in extenso nombre de partitions baroques pour la plus grande joie du public ? Si l'on ne regrette pas la disparition de certains ballets, surtout au vu de la chorégraphie risible de Mme Li, on peut déplorer que le final du deuxième acte, qui faisait l'admiration de Wagner, soit mutilé, et que les choeurs des trois cantons, si judicieusement caractérisés par le compositeur passent à la trappe. Par ailleurs, l'absence de reprises de certains airs laisse un arrière-goût de frustration et nous renvoie aux pratiques discutables d'une époque que l'on espérait révolue. Fort heureusement, même abrégée, l'admirable scène de Mathilde au début du trois est maintenue. Reconnaissons enfin que la cohérence dramatique de l'ensemble est globalement préservée malgré tout. Loin de tout réalisme, l'Helvétie inventée par Peter Davison fait appel à notre imaginaire collectif : ses décors tout en bois suggèrent l'intérieur d'un chalet sur fond de montagnes enneigées, les arbres sont stylisés et les quelques rochers et pâturages qui apparaissent au fil des tableaux font penser irrésistiblement à certaine publicité pour un chocolat suisse célèbre. Les danseurs revêtent les costumes tyroliens traditionnels, et bien que l'action se situe au XIIIe siècle l'apparition au second acte de Mathilde - princesse de Habsbourg, rappelons-le - évoque, par sa tenue, celle de Romy Schneider dans le Ludwig de Visconti. Dans ce dispositif commode à défaut d'être original, Francesca Zambello signe une mise en scène respectueuse du livret : aucune idée saugrenue, pas la moindre relecture psychanalytique ou iconoclaste : Guillaume Tell est un bon mari, un bon père, un patriote convaincu sans aucune faille ni perversion : il n'en fallait pas davantage pour désarçonner une certaine " ntelligentsia" toute parisienne, contrainte soudain de se concentrer sur la musique ! Et pourtant rien d'indigne dans ce travail, tout cela fonctionne bien et les interprètes peuvent chanter librement sans entrave aucune. Saluons d'emblée l'excellence des seconds rôles, si importants dans cet ouvrage, à l'exception peut-être d'un Gessler graillonneux et caricatural. Alain Vernhes, ce n'est pas une surprise, campe un Melcthal d'une grande noblesse. Toby Spence chante avec goût l'air charmant du pêcheur au premier acte. Nora Gubisch est une Hedwige de luxe et Gaële Le Roi un Jemmy idéal au timbre clair et juvénile : toutes deux contribuent à faire du trio féminin du quatrième acte un des grands moments de la soirée. Pour ses débuts à l'Opéra, Hasmik Papian n'a pas choisi la facilité : cette soprano qui excelle dans les emplois dramatiques verdiens - son Abigaille à Orange est dans toutes les mémoires semble chercher ses marques en Mathilde et ne parvient pas à faire croire aux dilemmes qui agitent la jeune princesse. Son français, en outre, n'est pas un modèle d'intelligibilité. "Sombre forêt" manque de legato et de moelleux et "Pour notre amour" de souplesse. Il faut attendre la fin du troisième acte pour que la voix se libère enfin dans un "barbare !" retentissant adressé à Gessler. Souhaitons son prompt retour in loco dans un emploi mieux adapté à ses grands moyens. Thomas Hampson incarne le rôle-titre avec conviction et subtilité. Sa maîtrise de notre langue est proche de l'idéal et son jeu, tout en sobriété, parfaitement crédible. La voix n'a rien perdu de sa splendeur, et si le timbre s'amenuise parfois dans les notes les plus graves il n'en conserve pas moins toute l'autorité requise dans les scènes héroïques. Voilà un Tell de haute volée qui nous gratifie d'un "Sois immobile" bouleversant d'intériorité. On n'oubliera pas de sitôt son "Jemmy, songe à ta mère" à vous arracher des larmes. L'Arnold électrisant de Marcello Giordani a dissipé toutes les craintes que l'on pouvait avoir après son Pirate stridulant de l'an passé au Châtelet. En très grande forme vocale, le ténor italien s'est admirablement tiré d'une partie réputée inchantable, sachant traduire les tourments du jeune homme tiraillé entre son amour et sa patrie. Son timbre se fait suave dans les duos avec Mathilde et déchirant lorsqu'il chante : "O ciel, ô ciel ! je ne te verrai plus" après l'annonce de la mort de son père. Cette interprétation trouve son sommet dans un "Asile héréditaire" impeccablement nuancé et couronné d'un aigu irréprochable et parfaitement tenu. C'est lui finalement qui sera le plus acclamé au rideau final. Les choeurs, excellents, ne contribuent pas peu au succès de l'entreprise et l'orchestre rutile de sonorités magnifiques : cordes somptueuses et vents flamboyants. Hélas Campanella n'a pas su rendre sa cohésion à une partition si riche et foisonnante. Privilégiant l'aspect martial de l'ouvrage, il donne à entendre une succession de morceaux mis bout à bout, à défaut d'une conception d'ensemble pertinente. En dépit des quelques réserves et malgré les coupures, le spectacle ne manque pas de ravir tous les amoureux de Rossini, heureux de voir représenté cet authentique chef-d'oeuvre, jalon incontournable dans l'histoire de l'opéra. A en juger par l'enthousiasme du public, ce Guillaume Tell a su rallier aussi les coeurs de tout ceux qui le découvraient. Est-ce un voeu pieux de souhaiter très vite une reprise de cette production afin que l'archer triomphant retrouve la place qui lui est due dans le répertoire de l'institution qui l'a vu naître? Christian Peter |
|
ALTAMUSICA 18 mars 2003 Nouvelle production de Guillaume Tell de Rossini à l'Opéra de Paris. Par Gérard MANNONI Une production beigeasse comme ses décors. On pourrait résumer ainsi l’effet produit par ce Guillaume Tell tant attendu, puisqu’il n’avait pas été vu à l’Opéra depuis 1932. Dans se version française, naturellement, ni vraiment intégrale ni vraiment massacrée, l’œuvre a raté son retour à l’affiche pour cause de mise en scène absente, de décoration fade, de direction orchestrale morose et de distribution très moyenne. Décidément, depuis son magnifique Billy Budd, Francesca Zambello alterne le chaud et le froid. Un Turandot ridicule, un Salammbo plutôt réussi, des Dialogues des carmélites minimalistes, La Guerre et la Paix impressionnant, un Boris Godounov très discutable et aujourd’hui un Guillaume Tell sans le moindre intérêt. Pas une idée personnelle, pas une image signifiante, rien que du convenu et du tiède, touchant parfois aux limites de la parodie. Le tout dans des décors couleur de copeaux, ni fonctionnels ni poétiques. Quant aux interventions chorégraphiques réglées par Blanca Li, soyons charitables en les oubliant au plus vite. Pauvres chanteurs largués dans ces eaux mortes et chargés de donner un semblant de vérité à des personnages par nature très conventionnels! Certains y parviennent, comme Thomas Hampson dont la voix n’a toujours rien d’italien et paraît assez terne dans ce répertoire, mais qui communique une vie théâtrale et musicale au rôle titre. Gaëlle Le Roi aussi, parfaitement crédible en petit garçon, confère à Jemmy une importance de premier plan. Un peu gauche car donnant l’impression d’être livré à lui-même, Marcello Giordani est le seul à posséder les moyens que réclame cette musique, même si la justesse a échappé par instants à sa grande belle voix si bien timbrée. Mais que peut faire Arnold face à une Mathilde aussi peu à sa place que Hasmik Papian. Pour ses débuts à l’Opéra de Paris, la soprano arménienne a paru constamment à côté de sa voix, ou plutôt de ses voix, car elle semble en avoir trois, tant son émission manque ici de sûreté et d’homogénéité. Le médium est gris, le grave absent et l’aigu jaillit en revanche comme pour les Norma ou Abigaïlle que cette artiste au demeurant respectable chante partout dans le monde. A l’évidence, la tessiture de Mathilde n’est pas pour elle. Le reste de la distribution était dominé par Nora Gubish, très présente dans la deuxième partie surtout et qui, à peine sortie de Perela, prouve encore la diversité de son talent et de ses possibilités. Tout comme Gregory Reinhart, lui aussi transfuge de Dusapin. On sait bien cependant que même sous distribué , un opéra peut toujours être sauvé quand le chef entraîne tout le monde dans une lecture dynamique adéquate. Bruno Campanella a semblé pétrifié par les mornes images qu’il avait sous les yeux et, passée l’ouverture, sa baguette n’a rien insufflé que de tiède à l’orchestre de l’Opéra dont pourtant les solistes ont été remarquables chaque fois qu’ils ont pu le montrer. Alors, si c’était pour proposer l’une des soirées d’opéra les plus ennuyeuses de la saison, et si l’on n’était pas certains de rassembler les protagonistes capables de ranimer un ouvrage qu’il faut quand même défendre, était-il raisonnable de réveiller Guillaume Tell ici après un si long sommeil ? On est en droit de penser que non. |
|
After 70 years, Rossini's final opera comes back to the company that premiered it, the Paris Opéra. The Return of Guillaume Tell By Frank Cadenhead Rossini wrote Guillaume Tell for the Paris Opéra, and he really wanted to get it right for several reasons. It was his first "grand opera" written for his newly adopted country, and he wanted it to have all the stylistic elements for success in the capital; he had recently been guaranteed a substantial lifetime pension by the French crown and he wanted to prove that he was worth it. More fundamentally, he felt the radical new winds of Romanticism in music blowing — he had already met Beethoven in Vienna and heard Berlioz. Feeling himself the proverbial "old dog," Rossini knew he had no impulse to explore this musical future and suspected that Tell might be his last opera — as indeed it was, although he lived another 39 years. In the event, Guillaume Tell was the success of the 1829 season and became a Paris Opéra staple. For a time — until the score, along with most of the bel canto repertoire, fell out of fashion — it was the standard by which grand opera in France was judged; it provided a template for Meyerbeer, Verdi and even Wagner when they went searching for fame in Paris. Tell was last performed at the Opéra in 1932, and its reappearance on the company's stage rights a historical wrong. This revival, performed in the original French and without the big cuts that have in the past disfigured this masterpiece, could have been a triumphant return. Unfortunately, the opening night performance never found its wings and seemed even longer than its four hours. The problem seems to lie in a pernicious idea of "grand opera" which is in current coin at the major international houses. As is often the case at the Metropolitan Opera, La Scala, the Vienna State Opera and Covent Garden, the management in Paris flies in renowned talent; a veritable United Nations of famous names is assembled (only a small percentage of which, for this very Gallic opera, were French), and the spectacle is given a splashy production on a grand stage. Questions of scale, delicacy in presentation and ensemble performance, to say nothing of historical style, are simply not asked. The assembled artists are without doubt among the best that money can buy — but is this the best approach for Rossini, or indeed for any opera? Consider the Italian conductor, veteran bel canto specialist Bruno Campanella. A regular at Paris, Covent Garden and the Met, he has been conducting this repertory to general acclaim for more than 35 years. His expansive vision and leisurely tempos always lend a feeling of grandeur and seriousness, and he has a good feel for the shape of a phrase. But if you like a bit of crackle and snap with your Rossini, you must look elsewhere: Campanella's thick orchestral sound and plodding tempos became downright irritating. One example is "Amis, amis, secondez ma vengeance," the magnificent tenor call to arms in Act Four (and a prototype, two decades later, for "Di quella pira" in Trovatore, complete with high Cs): the conductor gave the showpiece aria such a deliberate pace that you could feel the energy draining away, measure by measure. Fortunately, Thomas Hampson was in the title role: this consummate professional is always a pleasure to hear, and his aria "Sois immobile," urging his son to hold still with the apple on his head, was movingly delivered. Usually a fine actor, the American baritone was not given a fully defined character and sometimes resorted to bluster and posturing. Hasmik Papian, an Armenian dramatic soprano who stirred the critics with her appearances at the 2002 Orange Festival, was making her Paris Opéra debut as Mathilde; she seemed ill at ease as and showed little feel for the grace and legato line of bel canto style. French mezzo Nora Gubisch (who just finished an impressive turn in Pascal Dusapin's new opera Perelà) seemed more comfortable with the idiom and offered a Hedwige with true fire and heart. Another exciting young French singer, soprano Gaële Le Roi, sparkled in the role of Tell's son Jemmy. Marcello Giordani, Renée Fleming's co-star in Il Pirata at the Châtelet and the Met and one of the most compelling tenors on stage today, was an noteworthy Arnold; his hearty high Cs in the Act Four aria "Asile héréditaire" were impressive. French baritone Alain Vernhes brought rich, glistening tone to the role of Melcthal. For years this splendid veteran has toiled in the shadows of José van Dam and Gabriel Bacquier and has been seen in the world's major houses only recently; sadly, his character is consumed by fire at the end of the first act. The American bass-baritones Jeffrey Wells and Gregory Reinhart made solid contributions in secondary roles; as Rodolphe, Slovak tenor Janez Lotric seemed nervous in his outsized helmet and started the Act One finale a few beats ahead of the conductor. This production is the third by Francesca Zambello this season at the Paris Opéra, and her sunny, outdoorsy staging was a pleasure to look at. So were the IKEA-style scenic abstractions (there was a liberal use of pine) by Peter Davison; in the most inventive stroke, a fallen tree trunk was transformed by a shift of lighting into a dragon in time for the love duet, thus extending the realm of what constitutes a phallic symbol. Marie-Jeanne Lecca's costumes for the Swiss patriots were traditional, and the oppressors obligingly wore black. Blanca Li's ballets, however, looked more influenced by the film Seven Brides for Seven Brothers than by any Swiss country dances. Guillaume Tell is a centerpiece of the Opéra's season, and the house assembled quite an array of talent for it. Tighter ensemble work, singers more comfortable with bel canto and inspired conducting might have ignited the infectious energy and freshness Rossini so generously spread throughout the score and made the opening night an evening to cherish. This production will be recorded for television later in the run; perhaps by then the talented cast will be singing with more ease and freedom. Copyright © 2003 andante Corp. Rossini: Guillaume Tell Libretto by Victor-Etienne de Jouy and Hippolyte Bis from the play by Friedrich von Schiller Thomas Hampson (baritone) - Guillaume Tell A native of San Diego, andante contributor Frank Cadenhead is a former producer of classical music events; as a volunteer, he has assisted various performing arts organizations in California. He has lived in Paris since 1999 and is now a freelance critic and writer about music and opera in France. |
|
Guillaume Tell, il ritorno Era dal 1932 che una delle opere più significative del repertorio francese non veniva eseguita sulla scena dell’Opéra de Paris. "Guillaume Tell" torna sul palcoscenico, ovviamente in una sala diversa da quella per cui fu composto da Rossini proprio qui a Parigi nel 1829: questa volta il grande affresco storico di sapore svizzero invade l’immensa Bastille. E l’opera rossiniana torna alleggerita: questa versione dura meno di tre ore, ciò significa che un buon terzo della musica originale è stata amputata. Grossolanamente, né l’edizione critica di Beth Bartlet né il colossale lavoro che la musicologa canadese ha compiuto nel corso degli anni intorno all’ultima opera di Rossini sono menzionati nel programma di sala: segno di scortesia o di incompetenza? Il parere della Bartlet sarebbe stato per altro utile per stabilire i tagli necessari alla rappresentazione scenica perché, a parte le scene abituali (come quella della cappella), non si è esitato a sforbiciare cori e balletti, errore imperdonabile perché sicuramente si tratta delle pagine migliori della partitura di Rossini. Ma il pubblico ha comunque apprezzato: l’orchestra, diretta da Bruno Campanella habitué di Bastille, è apparsa in grande forma specie per i passaggi solistici. Purtroppo satura rapidamente nei "tutti", ma questo è soprattutto da addebitare alla non felice acustica del teatro che non rende giustizia alle finezze dell’orchestrazione di Rossini. Senza dubbio a causa del volume sonoro dell’accompagnamento, molti cantanti sono in difficoltà nel registro grave; la voce, pur enorme, d’Alain Vernhes sembra poco a suo agio nel ruolo del vecchio Melcthal, Hampson non riesce a fare risuonare che la parte acuta del suo ruolo, Jeffrey Wells (Gesler) è appena percettibile. Si devono notare le prestazioni eccellenti di Nora Gubish (Hedwige), de Gaëlle le Roy (Jemmy), de Toby Spence (il pescatore) e di Wojtek Smilek (Walter) nei ruoli secondari. Hasmik Papian offre una commuovente Mathilde e i suoi accenti, sprovvisti ancora di una buona pronuncia del francese, ci ricordano la sua Elisabeth nel "Don Carlos" di Verdi. Ben altra è la prestazione di Marcello Giordani che riesce, in un colpo solo, a farci dimenticare il suo Gualtiero poco convincente nel "Pirata" dello scorso anno e soprattutto l’Arnold di Chris Merritt. Contrariamente a quest’ultimo, Giordani ha veramente i mezzi vocali del ruolo e la sua interpretazione, benché forse un po’ debole in finezza, si è rivelata di una forza e di un impegno drammatico di grande impatto. Ha ricevuto le ovazioni del pubblico che attende ormai molto da lui per il suo Henri nelle "Vêpres siciliennes" tra poco meno di due mesi. Il maggiore merito della produzione resta la realizzazione scenica e in particolare la qualità dei "décors" di Peter Davison, e i costumi di Marie-Jeanne Lecca: scelte raffinate che lasciano alle spalle la tristezza di certi fondali grigi di cui l’Opéra ha fin troppo abusato. La Svizzera è dipinta secondo le tinte pastello del bosco verdeggiante e delle montagne innevate i cui colori variano in funzione della luce del giorno e dell’oscillazione metereologica del cielo. Non ci si sarebbe potuto augurare meglio per la singolare rivoluzione "virtuosa" che Schiller ha voluto dipingere nella sua tragedia del 1804, fonte del libretto del "Guillaume Tell" di Rossini. Uno spettacolo raffinato alla riscoperta di un repertorio poco rappresentato. Alessandro Di Profio Guillaume Tell (Guglielmo Tell) di Gioachino Rossini libretto di Etienne de Jouy, Hippolyte Bis, con Armand Marrast e Adolphe Crémieux, dalla tragedia di Schiller (1804), basata su fatti autentici raccontati in una ballata (anteriore al 1474) prima rappresentazione: Parigi, Opéra, 3 agosto 1829 |
|
Rossini's French elegance goes missing in Paris By Richard Fairman The Opéra National de Paris is rightly looking to its history. Many great operas have been written specially for Paris and then ignored, but now the company is putting on new productions of three of them: Rameau's Les Boréades and Rossini's Guillaume Tell, are now in the repertoire, and Verdi's Les Vêpres siciliennes will come in June. The Rossini - his last and grandest opera - is the kind of ambitious project one feels the leading opera company in France should always have in its sights. Too often Guillaume Tell is left to the careless clutches of companies that turn it into a stock international opera, heavily cut and sung in Italian translation by a motley selection of singers. Here, at last, was an opportunity for the opera to regain its Parisian identity. So what did we get at the Opéra Bastille? By and large a stock international opera, less heavily cut than usual and sung in French, but still with a cast and ambivalence of style that could have been anywhere, anytime, anyhow. The best features were exactly those one would expect from a well-regarded international company. The orchestra of the Opéra National de Paris maintains a high standard and its superb chorus, 102 strong (compare that to the figures at Covent Garden and English National Opera), gave Rossini's big choral climaxes a proud grand opera glow. Everything else lacked personality. Francesca Zambello's production, designed by Peter Davison, offered settings of impeccable Swiss cleanliness - neatly stripped pine trees, carefully arranged mountain vistas, freshly starched yodelling local folk. This was an old-style traditional production scrubbed antiseptically clean for modern consumption. The not-quite-picture-postcard-prettiness of it was pleasing at first, but where Rossini raises his game to high drama, Zambello dropped hers to low farce. By the time a miniature cuckoo-clock chalet went up in flames in the final battle scene, it had taken all the opera's stature and seriousness with it in a puff of smoke. Left to his own devices, Bruno Campanella showed a preference for trim rhythmic propulsion, but when his singers hit their main arias, the speed slowed. Thomas Hampson sang William Tell with strength and suavity of tone, emitting the outward signs of a personality, while leaving no impression of a real character. The soprano Hasmik Papian, as Mathilde, was generous with her voice, parsimonious with the words. Marcello Giordani's forceful Arnold received grateful thanks from the audience for confronting all the tenor's top C's without a flinch. None of them began to get to grips with the drama as Nora Gubisch's gritty Hedwige did, or Gaële Le Roi as Tell's spritely son Jemmy. The scene where William Tell shoots the apple off his head was a bull's eye - how did Zambello do it? - and an enjoyable coup de theatre. But where was the opera's French elegance, light and shade, verbal detail? Not in Paris. Maybe the size of the opera house at the Bastille renders that impossible. The revival of Tchaikovsky's Eugene Onegin there is on the same lines, well played under conductor Vladimir Jurowski, well rehearsed in Willy Decker's rigidly symbolic production, well sung by a thoughtfully chosen cast, including Olga Guryakova as Tatyana, Piotr Beczala as Lensky and Vladimir Chernov as Onegin. But it was rarely touching or interesting or individual. That is international opera - wherever it happens. Opéra Bastille, Paris 75012 |
|
Paris Opera: Reviving Rossini, the French one By David Stevens International Herald Tribune Operagoers here have been getting what, for many of them, is an introduction to a little-known composer of French opera. Well, no, Gioacchino Rossini is not little known, but his French operas are, and both of them have turned up recently to give some spice to the Paris season. They are "Guillaume Tell" and "Le Comte Ory," which made their appearances at the Paris Opera in, respectively, 1829 and 1828 - although Rossini had earlier converted two of his Neapolitan operas into French versions. At least four more works were planned, but political upheaval and ill health ruled otherwise, so Rossini's opera-writing career ended at age 37 and he spent his remaining 39 years amusing himself and his friends with more modest musical exercises. "Tell" - based on Schiller's play about the founding myth of the Swiss confederation - is one of the works that helped establish French grand opera, exploited by Meyerbeer and others and hanging on until well into the 20th century. But when "Tell" reappeared a couple of weeks ago at the Opera Bastille for its 912th performance by the company, it was a little more than 70 years since the 911th. Which is why most of the audience recognized the brilliant and ever popular overture, but not much else. From the start the opera had problems because of its great length and the banality of much of the libretto. Early on it was cut from four acts to three, and on some occasions only the second act was performed on a mixed program with other works. Told by a friend that he had seen Act 2 of "Tell" at the Opera, Rossini is said to have replied, "What? All of it?" Still the opera was praised my many (including Berlioz, not normally a Rossini enthusiast), recognizing that the composer had changed his style and was trying to produce something new. In this production there are four acts and a total of some three hours of music, which means that more than an hour of music has been cut. But the cuts have been made largely in ballet music and the reprises, leaving the story essentially intact. Still, with a long intermission, it is a long evening and on the whole one not equal to the score's musical riches. Bruno Campanella's conducting was little more than functional, Francesca Zambello's staging was efficient traffic direction, Peter Davison's sets were mainly generic Alpine views and a "somber forest" of leafless trees, peopled with folk in Marie-Jeanne Lecca's anonymous costumes. Blanca Li's choreography was energetic, and when the time came for Tell to fire his crossbow at the apple on his son's head it worked explosively. Thomas Hampson cut a fine figure as Tell and sang strongly, but the strength of his baritone is in its upper reaches and not always an ideal fit for the role. Marcello Giordani tackled Arnold's dauntingly high tenor role in vigorous full voice (whereas Adolphe Nourrit - the original Arnold - relied on his head voice to reach the stratosphere). Hasmik Papian was on the pale side as Mathilde, the Austrian princess loved by Arnold, and Nora Gubisch as Tell's wife Hedwige and Gaele Le Roi as son Jemmy turned in fine performances. Some of the strongest singing came in the smaller roles - Alain Vernhes's solid Melcthal, Jeffrey Wells as the tyrant Gessler and Gregory Reinhart as Leuthold. Performances at the Bastille run through April 10. [...] Copyright © 2003 The International Herald Tribune |
|
Jorge Binaghi
Ambiguo título. Adrede. Cuando las cosas van mal, encontrarse de pronto en
el sitio que ocupó la Bastilla convertido en teatro de ópera, ballet y concierto hace confiar en que pese a los retrocesos que nos toque padecer el mundo irá a más, no a menos. Que después del silencio comenzado en 1932, justo ahora se estrene una nueva producción de la última ópera de Rossini, esa tan "rara", tan "distinta", tan "monumental", tan "terrible", tan llena de futuro sin dejar de echar una mirada para nada despectiva al pasado, parece confirmar la hipótesis. Pese a las pocas ocasiones (siempre serán pocas), he tenido la suerte de ver con relativa frecuencia el Tell, y en alguna ocasión hasta mejor -en conjunto- que aquí. Pero así como Nabucco en la Scala o Don Giovanni en Praga, aunque no hayan sido para nada los mejores, me hicieron participar de una atmósfera que no se da en ninguna
otra parte (en el caso de la ópera de Verdi es electrizante de conmovedor), me sorprendí a mí mismo emocionándome de un modo muy especial con Guillaume Tell en París. Un domingo a la tarde muy temprano (casi cuatro horas de música, dígase lo que se diga no fácil), con un sol radiante, una situación pesada, y el aforo estaba al completo, el público inusualmente atento y si bien no aplaudió demasiado en el transcurso de la función hubo momentos de una
atención y tensión especiales. Nunca más grande que en la breve escena final de invocación a la libertad restaurada en una naturaleza pacificada (nunca tuvo una tormenta semejante sentido en Rossini -aunque fuera sólo por esto, y no es el caso, el título sería fundamental en la historia del género). El aplauso que siguió a las notas finales fue enorme, casi un rugido (en la medida en que pude darme cuenta, visto que yo estaba haciendo exactamente eso): nunca me había dado cuenta -aparte de mentalmente y por haber leído el corto pero meduloso análisis de Fedele D'Amico en Il teatro di Rossini: ¡Cómprenlo ya si no lo tienen!- de la renovación del tema shakespiriano del hombre como microcosmos que perturba a la naturaleza con su mal obrar y que por eso mismo debe restaurar el orden en el macrocosmos. Aquí fue clarísimo desde el clima bucólico inicial en medio del desastre a la serena paz duramente conquistada del final. Shakespeare sabía que la música era el arte más apto para ponernos de acuerdo con nosotros mismos y el mundo y Rossini le da la razón. No sólo es capaz de convertir lo que parece ser un inevitable "finale primo" con su característico "crescendo" en un concertante que diez años antes de Oberto hace pensar en Verdi, no sólo escribe una obertura inédita en él y absolutamente específica. Para seguir con Verdi (y antes), nunca se insistirá bastante en el carácter de padre del protagonista ni en esa estremecedora melodía, simple y corta y tan poco "rossiniana" (cuando queremos reducir a los genios, decimos estas tonterías) que es la única aria del protagonista en el momento de tener que disparar la flecha sobre la cabeza de su hijo. Pero es que también la entrada de Mathilde con su aria de amor a la naturaleza y a un hombre es especial en la obra rossiniana y cargada de referencias posteriores: que el autor haya tenido la visión de lo que traía ese siglo, lo plasmara de modo genial y luego ya no volviera a escribir ópera -probablemente porque ese mundo que como adelantado descubría no era el suyo- es un signo claro de grandeza, inteligencia, sabiduría, comprensión y hasta resignación. Si hoy tuviéramos un Rossini ... En realidad lo tenemos porque sigue teniendo sus lozanos 37 años, pero hay que servirlo bien. La Opera de París se esmeró, aunque no parece haber afinado la puntería en cada una de las opciones. Francesca Zambello ha hecho muchas mejores cosas aquí mismo, y ni los decorados la ayudaron (el del último acto fue un auténtico suplicio de publicidad cinematográfica de chocolate suizo; los otros estuvieron algo mejor, sobre todo el primero), ni algunos de los protagonistas parecían demasiado interesados en hacer creíbles su personajes. Al menos la directora comprendió que lo fundamental estaba en la música y no la estorbó: la ilustró, no siempre adecuadamente, pero no la perjudicó. En cambio, nunca he oído personalmente a Bruno Campanella tan acertado en una ópera como en esta, que es complejísima. Concertó con verdadera maestría, sus tiempos -otras veces discutibles- fueron justos y sólo faltó cierto brillo en las danzas (buena coreografía de Blanca Li, que, con algún exceso, logró hacerlas formar parte del drama) y cierta intensidad en algunos de los
grandes conjuntos. La orquesta le respondió bien (salvo un desliz de los trombones en la obertura, justamente) y el coro estuvo en un gran día y los aplausos a su director lo confirmaron. El más aplaudido a telón abierto fue Marcello Giordani. Me convenció más que en su pasado Pirata, los agudos suenan menos forzados y más seguros, pero el fraseo sigue siendo trivial y en algunos momentos innecesariamente lastimero; el francés ha mejorado, pero no siempre el fiato le responde y especialmente centro y media voz se destimbran. Como artista es inexistente (por ser piadosos) y pese al empeño, el dúo del segundo acto le costó y la afinación fue el precio por unos agudos; realmente lo que mejor cantó fue su terrible aria, pero la cabaletta siguiente hizo pensar en algunos comentarios de Rossini sobre Duprez cuando éste le cantó en privado la versión con el famoso "do de pecho". Hasmik Papian tiene voz, mucha, pero tampoco parecía muy interesada en lo que ocurría, fue incapaz de cantar piano (y "Sombre forêt", justamente escrita para la Cinti, está llena de sutilezas y matices que aquí ni se escucharon: es más, el aria parecía aburrida y no lo es). No sé por qué, aparte del hecho de dar la versión integral, no se cortó su segunda aria: es la única que detiene la acción (más que las danzas) y pese a que las agilidades son pocas, hace falta una belcantista, cosa que Papian no es Más cómoda y mejor estuvo con su chorro de voz -metálica y muchas veces opaca- en el gran concertante del tercer acto y en la plegaria del cuarto. Wojtek Smilek sigue cantando cada vez mejor su 'Walter', que ya le he oído en dos ocasiones: el bajo polaco es un elemento más confiable e interesante que algunos nombres que dan vuelta por allí. Claro que le tocó como 'Melcthal', el padre de 'Arnold', Alain Vernhes, que fue el más sonoro,
de un estilo y articulación únicas y un excelente artista. Traerlo a él para la breve pero importante parte y a Janez Lotric (que en otras funciones cantará 'Arnold') para la aún más ingrata (y difícil) del sicario 'Rodolphe' hizo pensar en la Opera de París de 1830. Incluso una parte menor como la de 'El cazador' estuvo bien servida por Vincent Menez. El odioso 'Gesler' fue el más que correcto bajobarítono Jeffrey Wells, muy en carácter. 'El pescador' que tiene sólo una intervención de gran dificultad e importancia estuvo en las excelentes manos de Toby Spence, al que sólo hay que reprocharle -si eso es posible- un grave velado y feo, pero los saltos al agudo fueron impecables. En 'Leuthold', una parte aparentemente poco agradecida, se lució el timbre oscuro y el volumen de Gregory Reinhart. Optima fue la impresión que dejó Gaëlle Le Roi en otro de sus personajes de adolescente "en travesti", tanto por la desenvoltura escénica como por la excelencia del canto de su 'Jemmy'. Nora Gubisch -muy aplaudida, voz de gran importancia, excelente actriz, agudos un tanto estridentes- extrajo el máximo partido de la fiel esposa de 'Tell'. Pero sin 'Tell' (me disculparán los adictos tenoriles) no hay gran producción de esta obra. No creo que Thomas Hampson tenga la voz ideal para la parte, y de hecho en varios momentos de fuerza tuvo que oscurecer demasiado el timbre y el agudo resultaba luego abierto o gritado en los recitativos, y no siempre se lo escuchó como sería de desear en los concertantes. Pero es un actor estupendo, un cantante inteligente capaz de convertir esas limitaciones señaladas en virtudes, un dechado de musicalidad, un lingüista notable (¡Qué francés!) y un maestro del fraseo. No tuvo ni un solo aplauso después de la mencionada y emocionante "Sois immobile", precisamente porque logró sobrecoger, pero cuando apareció al final el clamor fue ensordecedor ... y merecido (aunque yo no frecuentaría tan seguido roles que lo pueden agotar más de la cuenta muy rápido). Me gustaría cerrar esta reseña, que por el momento cierra también para mí este repentino y bienvenido año rossiniano, con la primera frase en que Hampson impactó en el primer acto -algunas medidas posterior a su primera intervención: "Es aquí donde vivieron en paz mis antepasados, donde huyo de los tiranos y oculto a sus ojos la felicidad de ser esposo, la felicidad de ser padre". Porque del héroe nacional Rossini ha elegido la dimensión "familiar"; a 'Tell' no le queda más remedio que pelear para poder seguir viviendo en paz, pero también con dignidad: hay mucho que aprender todavía
de esta ópera, de este autor. París, 23 de marzo de 2003 |